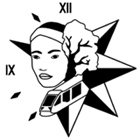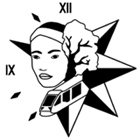Journée
thématique du 30
avril 2004
« Gestion
intégrée des espaces littoraux en baie de
Somme »
COMPTE-RENDU
Ensablement :
quelles causes, quelles conséquences, des solutions ?
Nicolas LOQUET, Docteur en océanologie, Groupement
d’Etudes des Milieux Estuariens et Littoral.
Mécanismes
de l’ensablement
Le
comblement de la baie par des sédiments est inéluctable
(la baie de somme est une ancienne vallée fluviale, mise en
évidence par sondage de présence de sédiments
marins fins). L’énergie nécessaire à éviter
l’ensablement vient des marées (le courant de la marée
montante est plus élevé que celui de la marée
descendante) et du phénomène de chasse continue (les eaux
continentales s’écoulent dans la mer) : ce qui suffit
à garder les particules en suspension.
Dans le cas de la Baie de Somme lorsque l’on se dirige vers le talus
continental, le frottement devient plus important lors des courants de
jusant (marée descendante), ce qui entraîne un
dépôt et une sédimentation du matériel
d’origine continentale au jusant à cause de ce
différentiel de marnage. Il y a une remise en suspension des
particules du fond lors des marées de vives eaux d’où une
quantité importante de sédiments lors du prisme de
marée (les apports sableux se font surtout lors des marées
de vives eaux).
A cela s’ajoute un mécanisme inverse : le pouvoir de chasse
de la Somme est trop faible car son débit n’est plus suffisant
(le fleuve est canalisé). Aujourd’hui on constate un
reméandrement qui grignote les mollières (= près
salés) sur une dizaine de m.
Causes
de l’ensablement de la Baie de Somme
- Apport sédimentaire entraînant la
réduction du delta sableux depuis une centaine d’années.
Il a été véhiculé vers l’intérieur de
la Baie ce qui risque de provoquer un déficit en matériel.
- Impacts de la spartine (plante envahissante, hydride
artificielle, qui concurrence de manière importante les
salicornes et spartine maritime locale Spartina maritima) :
cette plante s’installe à la faveur de l’ensablement, ce qui
participe au comblement de la baie par rétention des
sédiments. La spartine est en bas de shorre (où
s’installent les végétaux pionniers supérieurs)
donc elle stabilise les terrains en aval.
- Facteurs humains qui accélèrent les dynamiques
sédimentaires : les travaux d’endiguement ont cassé
l’énergie des marées et les variations de
méandrement (rectification des cours d’eau par canalisation)
Conséquences
- Modification du caractère
granulométrique : exhaussement des sédiments sableux
avec envasement des haut d’estran par les sédiments fins et des
bas d’estran par les matériaux plus grossiers.
- Elévation et réduction concomitante de la
slikke (vases salées non végétalisées), ce
qui a des conséquences écologiques graves car il y a une
perte importante de productivité primaire (fonction trophique
importante de ces zones) et de malacofaune benthique (ex : coques).
On assiste donc à une diminution des ressources pour certaines
espèces d’oiseaux, de poissons (zone de frayères) et
d’invertébrés (Néréis). Cette
réduction de la slikke a également des
répercussions économiques puisque l’exploitation
professionnelle (cueillette de coques par exemple) est de plus en plus
difficile. Cette raréfaction des coquillages touche environ 300
personnes en Baie de Somme.
Solutions
contre l’ensablement
Il
n’existe pas de solutions pour des ouvrages de grande ampleur, par
contre des actions ponctuelles peuvent être envisagées.
- Limiter la progression de la spartine et donc la
rétention des sédiments : cette lutte favorise les
espèces pionnières comme les salicornes (exploitées
et commercialisées), ce qui a des répercussions
environnementales mais aussi économiques. La résilience
du milieu (capacité à retrouver son état initial
après perturbation) semble se faire relativement bien. En effet,
la dernière espèce disparaissant avec l’installation de
la spartine, est la première à réapparaître
après élimination de cette plante envhaissante.
- Ré-estuarisation : ceci permettra de redonner de
l’énergie aux mouvements de marée (projet de la Maye pour
ouvrir une brèche dans la digue)
-
Dépoldérisation en
remettant en eau les renclôtures (terrains gagnés sur la
mer). Ceci a une vocation environnementale et un gain de
fonctionnalité, notamment sur le rôle de nurserie de la
baie pour les poissons.
- Solution drastique : on pourrait envisager de retirer
autant de sédiments qu’il n’en rentre (700 000 m3/an) mais les
impacts seraient non négligeables sur le milieu et le devenir de
ces sédiments ne serait pas réglé.
Le comblement a donc
toujours existé en Baie de Somme mais certains travaux
d’aménagement ont amplifié le phénomène
(endiguement). La question primordiale étant de savoir à
partir de quelle surface d’herbus l’estuaire devient-il
improductif ?
(c) Com'etes - 2004