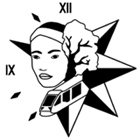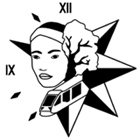Journée
thématique du 30
avril 2004
« Gestion
intégrée des espaces littoraux en baie de
Somme »
COMPTE-RENDU
La
stratégie de développement local en baie de Somme :
exemple d’opération grand site (OGS)
Sébastien
DESANLIS, chargé de mission au Syndicat Mixte pour
l’Aménagement de la Côte Picarde (SMACOPI)
Le SMACOPI et ses pôles de
compétences
Ce
syndicat mixte fut créé en 1974 pour favoriser le
développement des structures en Baie de Somme et son pourtour,
avec pour objectif le développement côtier et la
protection des milieux existants.
Le syndicat regroupe 18 communes du département de la Somme, et
a pour compétence la protection des milieux naturels,
l’aménagement du littoral et sa gestion. Il existe un
partenariat étroit avec les associations de protection de la
nature, le conservatoire du Littoral, et les pouvoirs publics.
Protection
et gestion des milieux naturels
Le
SMACOPI gère 5 000 ha de milieux naturels : la
réserve naturelle avec le parc ornithologique du Marquenterre,
ainsi que des secteurs d’anse de marais, d’anse dunaire, d’anse de bois
maritime (atypique), une réserve de chasse (ONCFS) et rare un
cordon de galets, qui constitue ici un milieu original.
Les
compétences du SMACOPI comprennent la gestion de la
réserve naturelle, mais également la rédaction des
documents d’objectifs Natura 2000 et les études préalables
pour le classement des sites du sud de la baie.
L’aménagement
Les
objectifs en matière d’aménagement consistent à
valoriser les villes et les zones rétrolittorales. Un projet de
ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) a pour vocation
d’accueillir les touristes sur l’année et non de façon
saisonnière afin d’obtenir un remplissage des logements sur
90¨% de l’année.
En ce qui
concerne la gestion intégrée des zones
côtières, un ouvrage de défense des bas champs est
mis en place pour maintenir le cordon de galets afin d’éviter
leur dérive littorale et limiter la formation d’une
brèche, qui provoque actuellement des inondations à
l’arrière de la digue.
En
projet : la création d’un réseau de pistes cyclables
le long de la cote picarde.
Les
compétences du SMACOPI englobent également la gestion
d’équipements touristiques telles que « Destinations
en Baie de Somme », les jardins botaniques, le golf,
l’hôtellerie, la restauration…
Opération
Grand Site (OGS) en Baie de Somme
Les OGS
visent des sites majeurs classés qui ont un fort potentiel
naturel menacé et fragilisé, et qui subissent la pression
voire la saturation par le tourisme (ex : Mont Saint-Michel.).
La
mission d’étude commanditée sur l’état initial du
site (paysage, milieu naturel, donnée socio-économiques
et fréquentation touristique) est réalisée par un
bureau d’études.
Etat
des lieux : pour les habitants et les touristes, la Baie de
Somme a avant tout une image de nature préservée. Elle
offre à la fois un paysage maritime emblématique, une
diversité des sites (bas champs, galets, dunes..), un patrimoine
architectural fort et un accueil balnéaire depuis le 19ème
siècle. Ce qui est capital, c’est de protéger les milieux
naturels tout en continuant d’utiliser les ressources touristiques pour
la gestion de cette nature.
Etude
de fréquentation : 750 000 visiteurs par an au Hourdel
sans offre de service particulière (mais avec des phoques
« stars »), juste pour voir le paysage.
L’étude montre une sensibilité des visiteurs aux
dégradations. En Baie de Somme, le potentiel d’accueil est
à son comble. Bien que le site soit classé, de nombreuses
menaces pèsent sur ce paysage : débordements de
l’architecture (absence de prise en compte des paysages pour les permis
de construire), menaces de modification paysagère liée au
dynamisme naturel telles que l’érosion, affalement de falaise,
ensablement de la baie (d’ici une trentaine d’années, l’estuaire
ne sera plus qu’une vaste pâture), consommation du rivage
(nombreux parking sur le front de mer), déploiement des
campings, dégradation liée au piétinement de la
végétation, etc. Le stationnement sauvage est
également une nuisance pour les locaux (camping-cars…).
L’affichage publicitaire (qui relève de la compétence du
maire) n’est pas réglementé, ce qui a pour effet une
dégradation du paysage. L’activité des carrières
est très importante, mais en phase de déclin :
quelle reconversion pour ces sites abîmés par l’extraction
et comment les intégrer dans le paysage de la baie ?
La
richesse du paysage et la constatation d’un processus de
dégradation qui menace le site ont amené à
projeter une Opération Grand Site sur 26 communes, afin de
concilier le développement du tourisme et de l’architecture avec
la conservation du patrimoine naturel. Cette OGS demandera beaucoup de
concertation pour aboutir à une zonation du site avec une zone
pour préserver les sites naturels et les paysages majeurs (noyau
dur), un territoire d’accueil des touristes (zone tampon) et un
pôle urbain.
Au niveau
des paysages majeurs, un contrôle avec sas est prévu pour
accueillir et encadrer le public. Les documents d’objectifs Natura 2000
devront préconiser ici l’absence de toute nouvelle urbanisation.
Les zones de bas champs (terres gagnées sur la mer pour
l’agriculture) doivent être également
préservées.
Pour le
pôle urbain, actuellement la majorité des habitations sont
secondaires, ce qui ne génère pas de retombée
économique. La politique de logement devra être
tournée vers une habitation à l’année.
Les
stratégies : les fiches d’actions seront
élaborées avec un financement de 50% par l’Etat.
La
gestion des milieux naturels et urbains : la politique de
gestion intégrée des zones côtières devra
composer avec la nature et les éléments climatiques afin
de maintenir le caractère maritime le plus longtemps possible.
Une politique de recul du trait de cote sera également mise en
place. La réhabilitation de la qualité tant
écologique que paysagère sera mise en avant,
contrairement aux autres plans de gestion, avec une réflexion
à approfondir sur la création de bio-corridors (quelles
espèces, quels flux, quel type de réservoir ?)
La
gestion du flux touristique : la détermination du
degré de sensibilité des sites et de leur
fréquentation permettra de mettre en place des moyens et des
règles adaptés à chaque site. L’accueil des
visiteurs pourra être réalisé au travers de
sentiers nature. Une gestion différenciée de cet accueil
serait nécessaire afin de limiter le nombre de véhicules,
et pourrait être réalisée en développant des
transports alternatifs à chaque point de rupture de charge
(navette, pistes cyclables, sentiers nature). Le sas a pour vocation un
accueil spécialisé des visiteurs. En leur donnant le
choix entre divers moyens pour découvrir le site naturel, cela
permettrait de réguler les impacts lors des périodes de
forte influence.
La
gestion du paysage urbain et péri-urbain : un effort
important reste à faire sur la revalorisation des sites
balnéaires dont le front de mer est dégradé
(parking, immeubles…). De plus, actuellement l’entrée des villes
n’est pas soignée (pub, HLM). Une charte de qualité reste
à instaurer sur ces communes, avec une révisions des PLU
(plan local d’urbanisme).
L’équipement
du territoire : parmi les priorités, le maillage du
territoire, la mise en réseau de l’équipement existant et
l’installation de lieux d’hébergements touristiques (gîte
ruraux et produits des fermes)
Phasage :
il existe un délai psychologique à respecter
nécessaire pour que la sensibilisation des élus et des
populations concernées soit réalisée avant toute
opération de grande envergure. Par exemple, réhabiliter
les sentiers pédestres et équestres nécessite le
règlement du conflit d’usage au préalable.
Concernant
l’acceptation par les communes, il y a une réelle importance
à maintenir ces milieux naturels face à l’augmentation de
la fréquentation, dont les élus sont conscients. La
discussion à l’échelle communale donne une vision et des
enjeux différents selon la taille des communes. De nombreuses
communes ont été englobées dans l’OGS afin que les
plus petites et les moins fréquentées soient mieux
conscientes des menaces qui pèsent sur les autres. La
réalisation de ces fiches d’actions n’a lieu qu’après
validation par l’ensemble des communes.
(c) Com'etes - 2004